44
Tu me libères des quer
elles du peuple,
tu me places à la t
ête des nations.
Un peuple d’inconn
us m’est asservi :
45
au premier m
ot, ils m’obéissent.
Ces fils d’étrang
ers se soumettent ; †
46
ces fils d’étrang
ers capitulent :
en tremblant ils qu
ittent leurs bastions.
~
47
Vive le Seigneur ! Bén
i soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Die
u de ma victoire,
48
ce Dieu qui m’acc
orde la revanche,
qui soumet à mon pouv
oir les nations !
49
Tu me délivres de to
us mes ennemis, †
tu me fais triomph
er de l’agresseur,
tu m’arraches à la viol
ence de l’homme.
50
Aussi, je te rendrai gr
âce parmi les peuples,
Seigneur, je fêter
ai ton nom.
51
Il donne à son roi de gr
andes victoires, *
il se montre fidèle à son messie,
à David et sa descend
ance, pour toujours.

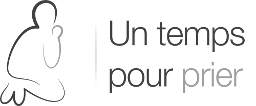
Commentaire
J’en appelle à l’empereur.
La phrase de Paul est restée célèbre. Tout citoyen romain avait le droit de choisir où et sous quelle juridiction il souhaitait être jugé.
Fraîchement débarqué, Festus tente de résoudre cette procédure qui n’en finit pas, mais il est «coincé» entre la délégation de Jérusalem et la citoyenneté de Paul qui lui donne des droits ! Heureusement !
Paul refuse de retourner à Jérusalem. Ses plus farouches adversaires pourraient faire basculer le vote du sanhédrin. Reste alors le tribunal impérial.
C’est finalement à Rome que le sort de Paul va se jouer.
Derrière le procès d’un homme, c’est la place d’une nouvelle religion dans l’Empire qui devient le véritable enjeu.
Et l’auteur des Actes ne croit pas si bien dire !
En 300 ans, traversant les persécutions, le christianisme finira par s’imposer.
En 313, Constantin fait du christianisme l’une des religions officielles de l’Empire. Le 28 février 380, les empereurs Théodose et Gratien font de la foi chrétienne l'unique religion obligatoire.
La chrétienté était née, pour grosso modo 1’700 ans.
Pour le meilleur et pour le pire.
Partagés entre la nostalgie d’une Eglise forte, dont l’évidence est reconnue dans la société, et la conscience des ambiguïtés de l’histoire de la chrétienté, osons prier pour retrouver aujourd’hui l’enthousiasme contagieux de l’Evangile et l’espérance confiante qui traversent les Actes des Apôtres.